Édition 2003
Du 21 au 30 mars 2003
25ème édition
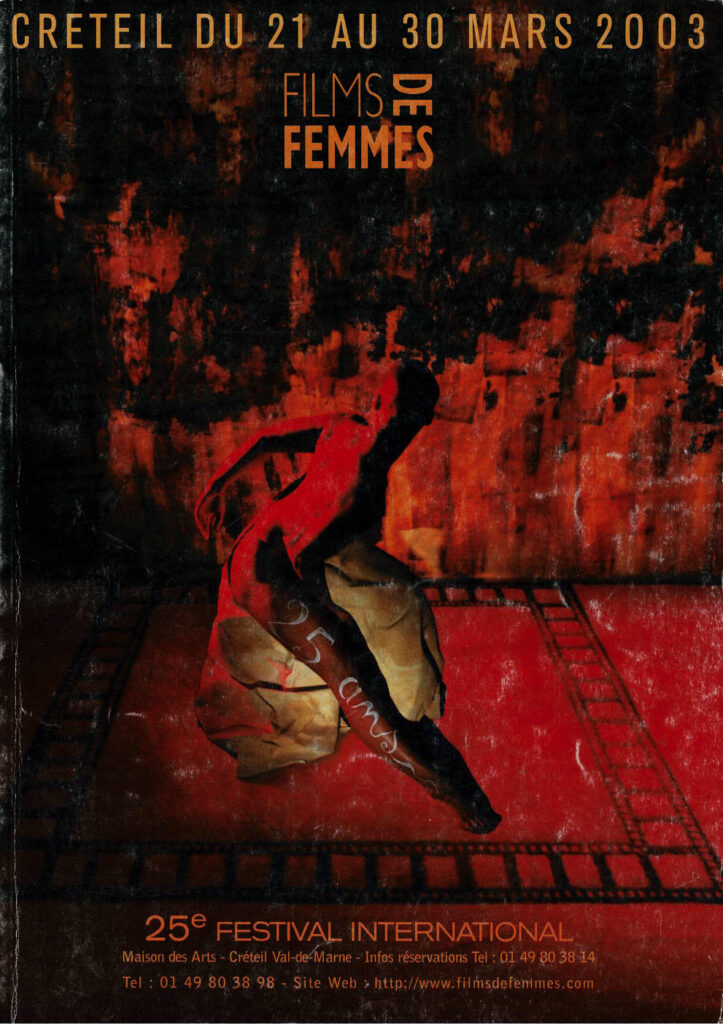
Du 21 au 30 mars 2003
25ème édition
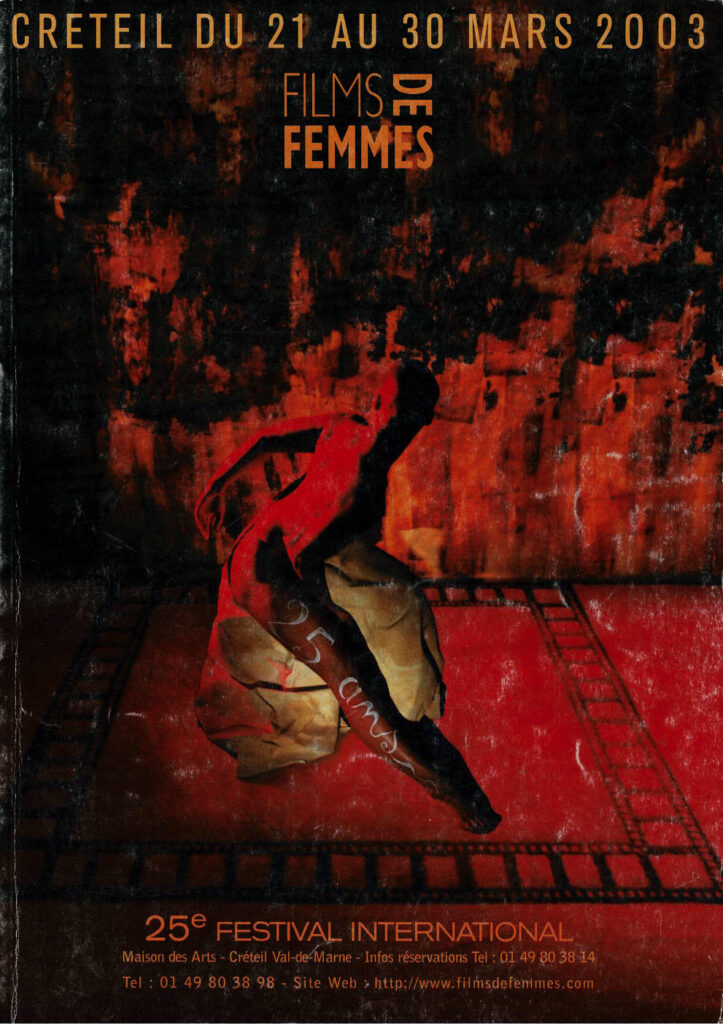
Beau soleil d’hiver sur Paris. Un froid coupant. Margarethe von Trotta nous reçoit dans son appartement parisien. Ambiance chaleureuse immédiate. Il y a là Ester Carla de Miro d’Ajeta, son amie et biographe préférée (1). Nous sommes dans le quartier où Germaine Dulac a tourné La Coquille et le Clergyman. Devinette : de quel quartier s’agit-il ? Après un fort café turc, l’entretien commence, régulièrement interrompu par le crépitement des portables. L’Inde, l’Italie, l’Allemagne à portée de voix… Mais écoutons la parole d’une très grande réalisatrice, également actrice et scénariste, dont les films n’ont cessé d’éveiller nos consciences.

Une enfance berlinoise dans un champ de ruines
Apatride jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, au moment de son premier mariage avec un citoyen allemand, Margarethe von Trotta a vécu son enfance à Berlin, dans les ruines de la seconde guerre mondiale. Fille d’une famille aristocrate russe ayant quitté le pays au moment de la révolution, elle porte le nom de sa mère, qui ne s’est jamais mariée. Son père, le peintre Alfred Roloff, venait les voir pendant les vacances. A sa mort, elle se rappelle la pauvreté de leur existence : « je n’avais pas de chambre à moi. Mon lit était côte à côte avec celui de ma mère. Elle travaillait et, chaque matin, me préparait mon dîner pour que je puisse avoir un repas chaud le soir, en rentrant de l’école. » Cette proximité la rend sensible à l’univers des femmes. Mélomane, sa mère lui apprend à apprécier la musique, la peinture, la littérature, et c’est avec elle que s’ouvre tout un univers artistique et imaginaire dont elle profitera plus tard. Cette enfance est bien sûr marquée par la guerre. Née en 1942, elle en subit toutes les conséquences. Mais, là encore, la petite fille ouvre les yeux, en attendant d’y revenir par le cinéma.
La rencontre avec le cinéma
Alors qu’elle effectue un séjour à Paris comme fille au pair, Margarethe commence à aller fréquemment au cinéma. C’est là que s’effectue une rencontre décisive. Elle découvre les films de Bergman, et son admiration est sans bornes. Pour elle, c’est le maître absolu, celui auquel elle se référera toute sa vie durant. « C’est vraiment avec Bergman que je me suis éveillée au cinéma, et que mon désir d’en faire à pris forme. » De retour à Berlin, elle entreprend des études de lettres et d’histoire de l’art, tout en commençant à interpréter des rôles comme actrice dans les films de la génération montante du cinéma allemand, ceux de Klaus Lemke (Brandstiffer, 1969), de Volker Schlöndorff (Baal, 1969) et de Rainer Fassbinder (Les Dieux de la peste…). Pendant une dizaine d’années, elle jouera dans une quinzaine de films, principalement ceux de Volker Schlöndorff, qu’elle épouse en 1971. C’est avec lui qu’elle coscénarise Le Coup de grâce en 1976, d’après un roman de Marguerite Yourcenar. Ce film obtient une renommée internationale. Elle y incarne le personnage de Sophie, dans une tragédie qui a pour fond politique la révolution russe de 1917 dans les pays Baltes, et qui la ramène déjà insidieusement à son histoire personnelle. « A ce moment-là, nous écrivions nos scénarios et nous faisions la mise en scène. Aucun producteur ne nous donnait de l’argent sur un scénario. Nous n’avions pas de commande, mais nous avions l’exemple de la Nouvelle Vague et de Godard, qui disait que de tout faire dans un film ce n’était pas une restriction, mais une richesse. »

Devenir réalisatrice
« En 1964, mon premier mari était un intellectuel très libéral et progressiste dans ses idées . Mais, à la maison, il était extrêmement patriarcal. Il fallait que mes désirs soient constamment tournés vers lui et vers notre fils, Félix. J’avais l’impression d’être emprisonnée. Plus tard, avec Volker, quelque chose de semblable s’est produit. Nous avons commencé par travailler ensemble dans une symbiose parfaite, nous écrivions ensemble, il me choisissait pour interpréter les héroïnes de ses films… tout allait bien jusqu’au jour où j’ai été sollicitée par d’autres. A partir de là, les choses sont devenues difficiles. Comme j’avais aussi envie de faire des films toute seule, ça n’allait plus. Lorsque Les Années de plomb a obtenu le Lion d’or à Venise (1981), il est devenu très jaloux. Finalement, il a choisi de vivre avec une jeune femme qui n’avait rien à voir avec le cinéma, et c’est à ce prix que ma carrière a démarré. »
La chance de Margarethe von Trotta aura été de commencer à faire du cinéma en étant portée par un courant, par un groupe de cinéastes, alors à l’apogée de leurs succès critique et public. « Nous étions dans une époque encore troublée par les événements de Mai 68. La guerre du Vietnam avait remué d’anciens souvenirs. C’est dans les années 70 que la jeunesse allemande a commencé à interroger son passé, et forcément ce passé était encore incarné par les parents. Donc, le conflit des générations a été très fort chez nous, car les enfants voulaient briser cette “chape de plomb” faite de silence et de non-dits sur la période nazie. Dans l’immédiate après-guerre, celle de mon enfance, les allemands étaient occupés à reconstruire le pays, mais cela a permis une sorte d’anesthésie des mentalités et de la pensée. » Avec la trilogie : Das zweite Erwachen der Christa Klages (Le Second éveil, 1977), Die Bleierne Zeit (Les Années de plomb, 1981), et Rosa Luxemburg (1985), le cinéma de Margarethe von Trotta affronte une actualité allemande qui fait retour sur son passé. La question du terrorisme, à travers le portrait des sœurs Esslin, est abordée par l’histoire privée des deux sœurs, une histoire qui détermine leur engagement politique, mais en même temps représente les contradictions d’une société en crise, crises sociales et crises personnelles fusionnant de manière parfaite. C’est également vrai dans le portrait contrasté de Rosa Luxemburg, jamais réduite à son image publique de théoricienne politique, mais perçue dans ses dimensions humaine et psychologique, dans son « identité divisée » (2). Dans les années 80, la France n’a pas connu le phénomène du terrorisme. En Allemagne, le terrorisme comme celui de la bande à Baader était dirigé contre le capitalisme allemand. C’était un règlement de compte interne à l’Allemagne. Aujourd’hui, c’est tout à fait différent, et le terrorisme attribué à Ben Laden et plus généralement aux islamistes est dirigé contre l’Occident. « J’ai toujours constaté, en Italie, au Japon ou en Allemagne, que le terrorisme est arrivé dans des pays qui avaient connu des régimes fascistes très importants. »
Départ de Berlin, puis retour à Berlin
En 1989, Margarethe von Trotta décide d’aller vivre à Rome avec un nouvel amour, Felice Laudadio. En Allemagne, les producteurs ne s’intéressent plus aux films des cinéastes de cette génération. La production allemande ne s’exporte plus. La mort de Fassbinder en 1982 semble porter un coup fatal au bouillonnement des idées, des talents, et à la richesse intellectuelle de cet âge d’or du cinéma allemand. A plus forte raison pour les réalisatrices (Ula Stöckl, Helma Sanders-Brahms, Ulrike Ottinger, Helke Sander, Jutta Bruckner…), qui se sentent isolées. Les comédies faciles alimentent le fond de commerce des producteurs, dans un marché interne peu exigeant. En Italie, Margarethe réalise Zeit des Zorns (Le Long silence, 1993), l’histoire d’un juge italien poursuivi par la mafia pour avoir mené une enquête compromettante impliquant des personnalités politiques. L’ombre d’Andreotti plane sur le film. Fidèle à elle-même, la réalisatrice aborde les choses à travers la vie quotidienne du couple, et la peur qui les tenaille à chaque instant de leur vie.
Au moment de la chute du Mur (1989), sollicitée par de nombreux ami(e)s, Margarethe hésite longuement, puis décide de revenir à Berlin pour y faire un film : « un pressentiment paralysant me faisait penser que ce n’était peut-être pas si beau que cela, que ce moment de joie intense ne durerait peut-être pas… N’ayant pas vécu à Berlin et en Allemagne de façon continue, je n’osais pas écrire seule ce film, j’ai donc demandé à Peter Schneider de l’écrire avec moi. Sans lui et sans l’aide de Felice Laudadio, je n’aurais pas fait ce film. » Ce sera Das Versprechen (La Promesse, 1995), qui la renvoie à son enfance. Berlin, sa ville divisée, est comme la métaphore de son cinéma et du statut particulier des femmes de sa génération. « Nous étions les premières à avoir ce sentiment d’être divisées entre le travail, les relations affectives, la famille, l’intérieur et l’extérieur. Un sentiment de dispersion et de division que nous avons dû affronter. Le féminisme nous a appris à le faire, et pour moi ces différents spectres se retrouvent dans mon cinéma et dans la façon dont je traite mes personnages féminins. » Mais la division s’opère aussi dans le passage de l’actrice à la réalisatrice. Objet de désirs sur lequel se porte les regards des spectateurs, et position de la réalisatrice qui regarde. Etre soi-même dans l’œil de la caméra, et ensuite à l’extérieur. Passage entre le statut d’objet et celui de sujet… infini retour d’un thème, présent dans tous les films de Margarethe von Trotta.
Pendant toute la période où le cinéma allemand n’a produit que des comédies, la réalisatrice travaille pour la télévision (Winterkind, Jahrestage…) en ayant le projet de revenir au cinéma avec Rosenstrasse, un film qui lui tient à cœur et sur lequel elle travaille depuis 1995. Lorsque les superproductions américaines que sont La Liste de Schindler (Steven Spielberg, 1993) et Le Pianiste (Roman Polanski, 2002) arrivent sur les écrans allemands, ils créent une polémique. Dans les années 70-80, les allemands n’avaient pas la maturité pour parler de leurs compatriotes qui n’avaient pas été des nazis. Faire un premier film sur quelqu’un qui a sauvé des juifs, cela aurait été très mal pris. Il fallait que ce soit les juifs américains d’Hollywood qui le fassent. Rosenstrasse arrive après cette polémique. « Mon film va sans doute déplaire, mais il raconte un fait historique. En 1943, des femmes aryennes qui avaient épousé des juifs ont individuellement été manifester dans une rue de Berlin, la Rosenstrasse, où leurs maris étaient enfermés avant d’être déportés. Ce mouvement d’abord très individualiste s’est amplifié et elles ont eu gain de cause, ce qui est miraculeux. La plupart sont restées fidèles, alors qu’à l’inverse les allemands qui avaient épousé des juives demandaient le divorce, pour protéger leur carrière et leurs intérêts. Jusqu’à maintenant, personne ne voulait entendre ce genre d’histoires. Il y avait un mythe qui perdure, comme quoi ces gestes courageux étaient impossibles. Comme les acteurs de cette période commencent à mourir, les témoignages de ce genre sont mieux acceptés, et pour les jeunes générations c’est évidemment essentiel. Je n’essaie pas de déculpabiliser la société allemande, mais d’éclairer par une petite lumière cette sombre période. » Là encore, Margarethe von Trotta établit un lien très étroit entre sa propre vie et l’histoire de son pays, une période, celle du nazisme, qu’elle n’avait jamais traitée aussi frontalement. Face à des producteurs qui lui lancaient : « Mais ça n’intéressera personne… on en a marre de ces histoires », elle tient bon, dans un mouvement initié entre autres par Barbet Schroeder (La Vierge des tueurs, 2000) pour un renouveau du grand cinéma historique allemand.
Propos recueillis par Elisabeth Jenny et Jackie Buet.
. (1) (2) Margarethe von Trotta, L’identità divisa, d’Ester Carla de Miro d’Ajeta (c/o Le Mani,Gênes, 1999).
. Cet article utilise également les informations d’une interview réalisée par Kiki Amsberg et Aafke Steenhuis (Rome, septembre 1996), parue dans Een Branding van Beelden, Gesprekken met vrouwelijke filmregisseurs (c/o Uitgeverij Contact,
Elles n’ont pas froid aux yeux!
Les femmes nordiques derrière la caméra

Harriet Andersson, Bibi Andersson et Gunnel Lindblom dans Les Filles de Maï Zetterling (Suède 1968)
Le Nord de l’Europe est composé de plusieurs zones géographiques : la Scandinavie (Suède, Danemark, Norvège), l’Islande, la Finlande et les pays Baltes. Chaque pays possède un héritage unique. La langue sépare la Scandinavie et l’Islande de la Finlande et des pays Baltes, où les récents conflits ont laissé des marques. L’Islande et la Scandinavie ont une langue commune, qui provient du nordique ancien, la langue des contes de fées et des poèmes médiévaux, bien avant les règles grammaticales du danois et du norvégien utilisées jusqu’en 1944. Depuis 1917, les pays Baltes vivaient sous la coupe de la Russie et n’ont acquis leur indépendance que très récemment, en 1991. En plus de l’estonien, du letton et du lituanien, le finnois et le russe sont couramment parlés dans les pays Baltes. La Finlande, longtemps dominée par la Suède et la Russie, est devenue indépendante en 1917. Aujourd’hui, le finnois est un amalgame de hongrois et de différents dialectes venus de l’ouest de la Sibérie, même si de nombreux Finnois ont le suédois comme langue d’origine.
En termes d’intégration européenne, la zone nordique est plus ou moins alliée à l’Union européenne. Le Danemark est le plus ancien membre de la CEE, depuis 1993, rejoint par la Suède et la Finlande en 1995. La Norvège et l’Islande se tiennent plus à distance de l’Union, à cause de désaccords concernant la réglementation sur le poisson et le pétrole. Les pays Baltes, quant à eux, attendent leur intégration dans la Communauté européenne.
En raison de toutes ces différences de cultures et de langues, il n’est pas facile de dresser un tableau unique des cinéastes nordiques, mais il y a eu depuis longtemps des réalisatrices dans chacun de ces pays. Deux festivals récemment créés témoignent de la situation. Le Nordic Glory, en Finlande, un festival pionnier (1997), bientôt suivi par Femmedia (1998), sponsorisé par la Svenska Kvinnors Filmförbund (Swedish Women’s Film Association) à Stockholm. Ces deux manifestations ont encouragé les réseaux de femmes réalisatrices. Mais, deux ans plus tard, la Swedish Women’s Film Association, fondée en 1976, a abandonné ses fonctions. L’une de ses fondatrices était la cinéaste Maï Zetterling, peut-être la meilleure cinéaste de l’après-guerre. Une fois regroupée au sein du Swedish Film Institute, l’association a vu ses conditions économiques devenir plus que « virtuelles ».
La Finlande a maintenu le Nordic Glory Film Festival et en 2002 a programmé une compétition regroupant vingt-trois films de réalisatrices, incluant : Eija-Liisa Ahtila, Antonia Ringblom, Kaija Juurikkala, Susanna Helke et Virpi Suutari. L’association organise un festival plus modeste des nouveaux films nordiques, courts et longs métrages de fiction et documentaires. C’est actuellement le seul festival annuel des pays nordiques à diffuser le travail cinématographique des femmes.
Plusieurs fois primé, Italian for Beginners, de Lone Sherfig (2000) est un autre film Dogme, qui, dans la province danoise, réunit un groupe d’amis à travers les leçons d’italien qu’ils prennent ensemble toutes les semaines.
Des subventions existent pour le cinéma, en Norvège, Finlande, Suède, Danemark et Islande. Les femmes réalisatrices sont maintenant diplômées des écoles d’art et de cinéma. Depuis peu, elles essaient d’obtenir des subventions de l’Etat pour faire des films. De nombreux films subventionnés passent ensuite à la télévision ou suivent le chemin des festivals. Dans I shall not want (Danemark, 2001), le film de Jytte Rex qui rend hommage à Palle Nielsen (1920-2000), son professeur, qui fut par ailleurs l’un des plus grands artistes graphiques du Danemark, est un assez bon exemple de cette procédure. Un autre exemple pourrait être celui de Solveig Anspach, réalisatrice franco-islandaise, dont le documentaire Made in USA a été projeté lors de la soirée de clôture du festival de Cannes. Elle a réalisé un autre documentaire sur la capitale de l’Islande, Reykjavík (2001), présenté dans notre programmation. De Norvège, signalons la présence d’Anja Breien, qui a étudié à l’Idhec (Paris) dans les années 60. Sa trilogie des Wives (Hustruer, 1975, Hustruer-Ti ar etter, 1985, Hustruer III, 1996) est un projet échelonné sur trente ans, qui se moque des « genders » rôles. To see a Boat at sail, son dernier court-métrage (2000), est nettement plus lyrique.
Née au Japon mais élevée en Norvège, Liv Ullmann, qui a longtemps vécu sous la tutelle d’Ingmar Bergman, a maintenant acquis son indépendance. Directrice du jury du festival de Cannes en 2001, elle a réalisé Faithless (2000), sur un scénario de Bergman. Le film a été vendu dans plusieurs pays et il a consacré Lena Endre, qui est l’une des meilleures actrices suédoises du moment. Ce film raconte la relation sentimentale du cinéaste avec une femme. La personnalité peut-être trop écrasante de Bergman rend difficile le travail des cinéastes en Suède. Peut-on rivaliser avec sa réputation ? Même les femmes subissent cet héritage. Mais Lisa Ohlin est une jeune cinéaste qui, avec Waiting for the Tenor (1998), a non seulement trouvé sa voie, mais a aussi obtenu un excellent accueil critique.
Du fait de l’héritage soviétique, les films des pays Baltes sont relativement peu connus. Diana Matuzeviciené, de Lituanie, a commencé à travailler à la Lithuanian Film Studio en 1969 comme assistante de direction. Elle a écrit de nombreux scénarios. Laila Pakalnina, de Lettonie, est diplômée du VGIK de Moscou. Elle a réalisé plusieurs documentaires, dont certains ont été sélectionnés à Cannes. Renita et Hannes Lintrop, d’Estonie, sont aussi des réalisateurs en activité dans cette région. Hannes Lintrop a travaillé dans une société de production indépendante, la SEE, à Tallinn. Ses films ont été primés dans des festivals en Australie, Estonie, Finlande, France et Pologne. En 1996, Renita et Hannes Lintrop ont réalisé un documentaire sur la pire des catastrophes survenue en période de paix, lorsque neuf cents personnes ont péri à bord du ferry l’Estonia.
Le plus important aujourd’hui est peut-être de favoriser l’émergence de festivals régionaux pour diffuser les films des réalisatrices du Nord. Pour le moment, il semble que la Finlande soit en tête des pays désireux de leur assurer une vitrine (le Nordic Glory). Une histoire de la démocratie et des comportements sociaux démontrerait les avantages d’une égalité pour les femmes, les personnes vivant en concubinage, les gays et les lesbiennes, dans les pays de la Scandinavie et en Finlande. Cela prendra beaucoup de temps pour que les pays Baltes se mettent au diapason. Dans ce climat, la situation devient plus difficile pour les femmes seules, à mesure que l’égalité semble acquise pour les autres. Le nombre des réalisatrices en activité est encore loin d’atteindre celui des hommes. Une chose est cependant certaine, le cinéma des réalisatrices nordiques est universellement reconnu, il possède une grande richesse de contenus et des thèmes variés.
MoÏra Sullivan, journaliste suédoise
(traduction Elisabeth Jenny)
Grand Prix du Jury – Meilleur long métrage de fiction
Il più bel giorno della mia vita de Cristina Comencini (Italie)
Mention spéciale Grand Jury
Karamuk de Sülbiye V. Günar (Allemagne)
Prix AFJ – Meilleur long métrage documentaire
The Day I Will Never Forget de Kim Longinotto (Doc, Royaume-Uni)
Prix Graine de Cinéphage – Meilleur long métrage de fiction
This Side of Heaven de Chen Jie (Chine)
Prix UPEC. Université Paris-Est-Créteil – Meilleur court métrage européen
Between the Wars de Emily Woof (Royaume-Uni)
PRIX Beaumarchais – Meilleur court métrage francophone
Ne m’appelle plus BB ! d’Olga Gambis (France)
Prix Programmes courts et créations CANAL + Meilleur court métrage
Pending d’Anna Tow (Australie)
Prix du Public – Meilleur long métrage de fiction (doté par la Ville de Créteil)
Il più bel giorno della mia vita de Cristina Comencini (Italie)
Prix du Public – Meilleur long métrage documentaire (doté par le département Val-de-Marne)
Georgie Girl d’Annie Goldson (doc, Nouvelle-Zélande)
Prix du Public – Meilleur court métrage étranger
Dancing in the Dust de Jenny Lowdon Kendal (Australie)
Prix du Public – Meilleur court métrage français
Alice de Sylvie Ballyot (France)