Anne Alvaro – Aventurière des mots en mode majeur
De sa voix si particulière, à la fois claire et voilée, Anne Alvaro guide la conversation. Ses intonations nuancées sont empreintes d’une autorité pleine d’élégance et de délicatesse. Au cours de l’entretien, auquel elle s’est généreusement prêtée, se dégage un portrait attachant et lumineux. Au-delà des multiples voix qu’elle interprète au théâtre comme au cinéma, on entend l’amour des mots : « Quand on est enfant, on aime les mots pour leur sonorité autant que pour leur sens. » Cet amour, non seulement elle le communique à ses spectateurs, ses élèves et ses étudiants, mais elle l’inscrit aussi dans un projet de longue haleine : l’enregistrement d’À la recherche du temps perdu de Marcel Proust.
Du côté de sa maison normande, elle fait de longues marches pour méditer sur les textes qu’elle va interpréter : « Tous mes rôles, je vais les tremper dans la forêt », dit-elle sur un mode poétique.
Au commencement…
Née à Oran, j’ai passé toute mon adolescence à Créteil. J’ai étudié au lycée Marcelin-Berthelot, où j’allais à bicyclette, je prenais la passerelle et je passais derrière ce que vous appelez maintenant le vieux Créteil.
À 9 ans, j’ai fait mes débuts au conservatoire municipal. Le professeur s’appelait Alain Souchère. Pendant trois mois j’ai été l’unique élève de la classe, répétant seule sur le plateau L’École des femmes (« le petit chat est mort… »). Je prenais l’autobus.
Dans ces moments-là, hors du temps, j’ai découvert le plaisir de dire les mots des autres, qui investissaient mon imaginaire tout en me laissant une absolue liberté. J’étais le centre du monde, sous le regard de mon prof, qui m’apprenait des choses. Le théâtre était le refuge immédiat pour tous les rêves possibles. Je n’ai plus jamais voulu quitter cet endroit.
Est arrivé Mai 68 et j’ai refermé la porte du conservatoire. J’avais 19-20 ans. J’ai tout de suite travaillé dans la compagnie de Denis Llorca. Nous avions le même âge et il était mon compagnon. Pendant 7 ou 8 ans j’ai joué Shakespeare, d’abord et avant tout Shakespeare.
En 1968, tout a explosé, tout était possible, une vraie liberté, la liberté d’une époque. On montait un spectacle, on trouvait un lieu, on collait des affiches la nuit, on faisait venir des gens et on jouait, on jouait n’importe où. Ces années d’apprentissage ont été les plus fortes. C’est à cet âge-là qu’on fait les rencontres marquantes, qu’on porte un auteur comme on porte un étendard dès que l’on se retrouve sur un plateau et avec des partenaires.
La liberté suscite la curiosité des aventures théâtrales venues d’ailleurs, par exemple des Etats-Unis. J’ai travaillé avec Bob Wilson dans Le Regard du sourd, qui a été un choc.
Juste avant, j’avais rencontré Jean Négroni pour Dieu aboit-il ? au théâtre des Mathurins avec Jean-Pierre Darras.
Jean Négroni m’avait vue dans une représentation de fin d’année au conservatoire de Créteil et c’est lui qui m’a ouvert la voie en me disant : « Le théâtre, c’est ça et toi tu es à ta place, tu es là. » Il venait d’être nommé directeur de la Maison des Arts de Créteil en préfiguration dans la salle Jean Cocteau de Créteil Village.
C’est un épisode important, le début de grands projets de décentralisation à travers les maisons de la culture.
J’ai toujours travaillé dans le théâtre public. Pour moi, c’était une évidence même, c’est ce qui m’a construite, la ligne conductrice. Au cours de mes rencontres avec des hommes de théâtre, je me suis rendu compte que j’avais non pas une capacité, ni une compétence, mais un potentiel. Il me suffit de creuser dans ma mémoire, d’être attentive à l’autre et de me servir de mon acquis. On ne transmet pas l’expérience, tout juste un regard, un point de vue. Mais est-ce qu’on devient acteur ? Je n’en suis pas sûre. Par contre, je ne sais plus qui disait qu’être acteur, ce n’est pas la volonté de l’être, c’est celle de le rester. Et c’est vrai qu’il y a des moments de découragement, d’hésitation, de doutes…
De doute, oui, heureusement. De doute sur les choix, sur la capacité de résistance et sur la ténacité. Effectivement, la volonté de le rester, c’est une étape obligée.
La vie se mêle au métier impossible de tracer des frontières
Mes choix ont évolué au cours des années. À un moment, je disais « c’est l’auteur », il fallait bien dire quelque chose, après je disais « non, non, c’est le metteur en scène. », « non, non, c’est les partenaires. », « c’est le rôle », ça dépend.
Je crois vraiment que c’est une histoire de moment. Il m’est arrivé assez rarement d’éprouver ça, je veur dire « ah, c’est pour moi maintenant. », reconnaissant la proposition, le projet, l’aventure possible.
Les grands metteurs en scène qui ont marqué ma carrière d’actrice
Dans une interview, Jean Négroni dit que le rôle d’un directeur d’acteurs est d’inoculer un texte étranger à un comédien dont le travail consiste à se l’approprier. Parfois, il peut y avoir rejet. J’ai connu de longues collaborations. Mais ma liste est éclectique. Denis Llorca, c’est sûr. Bob Wilson, qui m’a fait découvrir complètement autre chose, Raoul Ruiz. Et puis dans l’ordre des rencontres : André Engel, Bernard Sobel, Georges Lavaudant, Lucian Pintilié…
Ils ne se ressemblent en rien, mais évidemment il y a un champ commun entre eux, le théâtre. Chacun me fascine avec sa personnalité, sa culture, son passé. Quand je les ai rencontrés, tous avaient déjà imposé leurs visions personnelles, leur manière de travailler, leur relation à l’acteur, au texte et au plateau. En les abordant chacun tour à tour et sans oublier ce que j’avais appris des précédents, je tentais de me plier à leur volonté et d’exaucer leurs désirs. Il faut un temps, le temps du théâtre, pour traduire l’autre, comprendre son langage, son regard, ses humeurs, ses secrets. J’ai oublié quelqu’un avec qui j’ai travaillé une seule fois, hélas ! Alain Ollivier. Je m’étai embarquée avec lui dans une incroyable aventure, Le Marin, de Fernando Pessoa (drame statique).
Quant aux femmes metteurs en scène, il n’y en pas eu tant que ça, mais ce fut à chaque fois une rencontre singulière.
Anne Torres, avec qui j’ai travaillé plusieurs fois, Anne Dimitriadis, Claire Lasne pour un Tchekhov.
La différence est peut-être dans l’à-côté, ce n’est pas rien, mais sur le plateau, c’est la même chose, même effort de traduction, même intérêt à découvrir une nouvelle manière de travailler.
Des expériences hors cadre
Ma première tentative de mise en scène m’a été offerte par les Appa, des Acteurs-Producteurs-Associés en une sorte de phalanstère grâce à Josiane Orville. On a pu faire « une action », un festival sur plusieurs semainesavec la possibilité pour chaque membre des Appa de proposer un geste artistique à partir du thème Conversation d’artistes.
À cette occasion, j’ai pu rencontrer John Berger, qui m’a donné les droits d’adaptation de quelques pages de son livre Un peintre de notre temps, que j’avais appelé Le Journal de Janos. C’est un spectacle qui durait 40-45 minutes, le bonheur total, un très beau souvenir.
C’était une vraie tentative de découvrir des projets solidaires autour de contenus originaux et qui n’a pas duré très longtemps. L’année, d’après le thème portait sur Conversation d’idiots, puis sur Le Bicentenaire. Là, on s’était attaqué à la Révolution.
Parmi les lecteurs il y avait Hélène Lapiower, André Wilms, Charles Berling, Anouk Grimberg.
Hélène Lapiower a tourné des films magnifiques sur sa famille. Elle a malheureusement disparu il y a une douzaine d’années. On avait tourné ensemble dans un court métrage d’Anne-Marie Miéville, Faire la fête, qui sortait en même temps que le film de Jean-Luc Godard Je vous salue Marie.
Charles Berling avait mis en scène avec Michel Didym une des réunions du groupe des surréalistes qui portait sur la sexualité, « Succubation d’Incubes ». TOUS étaient joués par des femmes : Anouk jouait Prévert, je jouais Aragon…
Le cinéma : « moteur, action »
« Moteur, action », c’est Agnès Godard qui me l’a enseigné.
Elle a été très pédagogue. En fait c’est avec elle que j’ai tourné pour la première fois, dans son film de sortie de la Fémis, La Lumière sous la porte. Elle m’avait contactée après avoir lu un article élogieux dans Libé. Je jouais à ce moment-là Hedda Gabler.
Mais j’ai vraiment eu l’impression de découvrir le cinéma avec Raoul Ruiz. Il est unique. C’est un enchanteur et l’un des premiers avec qui j’ai tourné plusieurs films coup sur coup. D’abord, il y a eu Bérénice produit par le festival d’Avignon. Il m’a donné la permission de jouer Bérénice au cinéma, ce que je n’avais jamais fait au théâtre. Et dans des conditions tellement singulières, tellement magiques… Je suis partie pendant un mois avec lui au Portugal pour tourner La Ville des pirates, après les quatre jours de tournage de Bérénice.
Grâce à Ruiz, je me rendais compte que le cinéma pouvait être un magnifique geste d’ouverture. Il convoquait le rêve, la magie, la marionnette, la peinture, la fantaisie la plus débridée. J’étais fascinée, ravie d’être cette créature-là dans son rêve, d’entrer dans ses propositions les plus loufoques, dans sa cuisine intime.
Raoul Ruiz on ne peut pas le cataloguer, c’est un poète, un inventeur. Sa culture est multilingue, son univers à la fois inapprochable et généreux, ouvert à l’autre. Quand il nous parlait, nous racontait des histoires, il me tenait sous le charme.
La grande différence entre cinéma et théâtre, c’est le rapport au temps. Au cinéma, c’est l’instant qui prime. Prenons la dernière expérience cinéma que j’ai eue, sur le tournage de Bertand Blier. J’ai compris que chez moi quelque chose avait un peu changé, j’avais appris à me mettre en veille. Ça, c’est assez magnifiquement comme état d’esprit, d’être en veille.
Mes choix de cinéma
Pour Le Goût des autres, la rencontre avec Agnès Jaoui réalisatrice et actrice, s’est faite au théâtre de l’Odéon où je jouais une pièce de B. Brecht. Agnès et Jean-Pierre sont venus dans ma loge. Une semaine après, je reçois leur scénario. Je me précipite, je le lis et c’est une merveille. Ils écrivent ensemble, mais pour le coup c’était le premier film d’Agnès. Je me souviens que sur le plateau régnaient une excellente organisation et une grande harmonie.
C’est un très beau sujet… Nous formions un équipage solidaire. Un sujet profond traité avec légèreté, à la limite de la comédie, sans jamais tomber dans la caricature.
Tous deux ont su trouver la distance juste avec suffisamment d’empathie pour les personnages. Ils parviennent dans ce film à éclairer les agissements de microsociétés qui conduisent à l’ostracisme. C’est un film plein d’humanité dont je pense qu’il restera.
J’ai choisi de montrer À mort, la mort!, le film que Romain Goupil a fait après Mourir à 30 ans sur la génération sida.
Il avait réuni ses potes de toujours et demandé à Brigitte Catillon, qui avait participé à l’écriture du scénario, avec qui elle voulait tourner. Brigitte avait aussitôt pensé à Christine Murillo et à moi (à l’époque nous étions trois inséparables). Il y avait aussi Brigitte Fontaine dans la distribution.
Entre-temps, j’avais tourné un autre film avec Romain : La Java des ombres.
Quand Claude Goretta m’a appelée pour interpréter le rôle de Simone de Beauvoir dans Sartre, l’âge des passions, je lui ai dit oui tout de suite.
Le personnage principal c’est Sartre, joué par Denis Podalydès, mais avec un Castor incontournable. C’était diffiicle.
Au cours de la préparation du tournage, les conversations avec Claude étaient très animées. Le sujet était essentiellement centré sur la période de la guerre d’Algérie jusqu’au moment où Sartre a refusé le prix Nobel. Par rapport au scénario initial, Goretta a beaucoup insisté pour étoffer le personnage de Simone de Beauvoir, qui avait été un peu minimisé. Il nous a laissé dans certaines scènes une grande liberté d’improvisation.
Les Bureaux de Dieu, de Claire Simon, est un film militant et politique. Claire a réussi là quelque chose de formidable. Son film a été précédé d’un gros travail d’enquête. Elle a passé plusieurs mois dans différents plannings familiaux. De là, l’idée très originale d’associer des actrices professionnelles à des infirmières et des conseillères du planning familial.
Quant au film de Blier, Le Bruit des glaçons, le sujet en est magnifique. J’ai aimé le scénario et en tournant avec lui, j’ai beaucoup admiré sa liberté de ton, son imaginaire. Le jour où l’on devait tourner la scène d’amour, Bertrand Blier nous annonce : « Je vais tourner la scène comme une femme, comme une femme filmerait un homme. »
Jean Dujardin est extraordinairement beau. Là, il est effectivement à travers le regard d’une femme. Il est magnifié. Ça lui donne une dimension très particulière.
J’ai aussi joué des garçons. Roméo dans Roméo et Juliette (tous les personnages étaient joués par des femmes) et un idéologue dans une pièce montée par Wajda. À la suite de quoi, il m’a fait tourner dans DANTON.
Comme un beau voyage
Il y a deux métaphores qui reviennent régulièrement dans le théâtre : les métaphores amoureuse et maritime. Pêle-mêle : l’embarquement, l’embarcation, la composition de l’équipage, la mer d’huile, la mer agitée, l’arrivée à bon port, les amateurs, la personnalité du capitaine, ses responsabilités, etc.
L’aventure sera toujours mouvementée, et toujours les comédiens espéreront la belle traversée.
Entretien avec Jackie Buet
Merci à Diana, à Ghaiss et à Hélène pour leur précieux concours de relecture et de corrections.
LE GOÛT DES AUTRES d’Agnès Jaoui
LA LUMIÈRE SOUS LA PORTE d’Agnès Godard
LE GOÛT DE PLAIRE d’Olivier Ducastel
DANTON d’Andrzej Wajda
LA VILLE DES PIRATES de Raoul Ruiz
À MORT, LA MORT! de Romain Goupil
LA CHOSE PUBLIQUE de Mathieu Amalric
SARTRE, L’ÂGE DES PASSIONS de Claude Goretta
LES BUREAUX DE DIEU de Claire Simon
LE BRUIT DES GLAÇONS de Bertrand Blier
![]()




























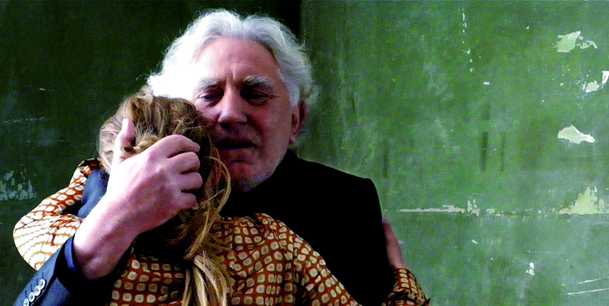
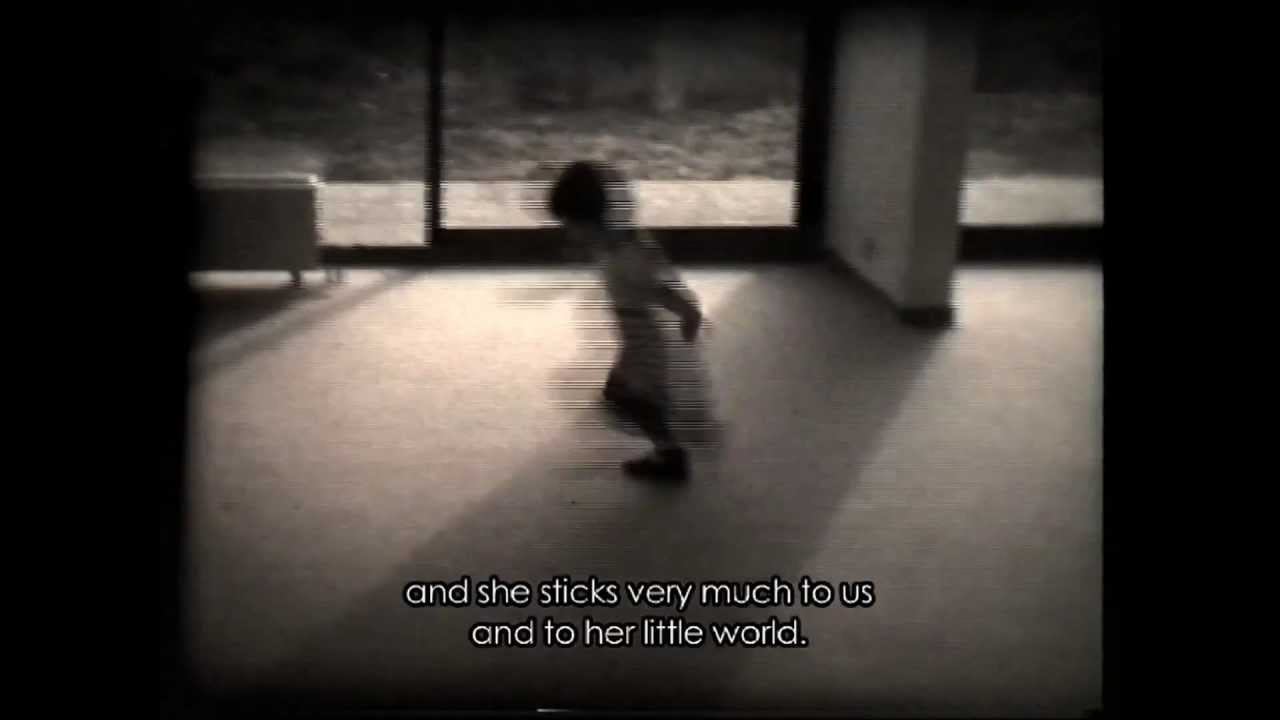














.jpg)